Giovanni LISTA. - Quand avez-vous connu Russolo ?
Nino FRANK. - J'ai connu Luigi Russolo au printemps de 1927, quand il était venu à Paris avec Marinetti, Prampolini, etc., pour les représentations des " Ballets Futuristes " au Théâtre de la Madeleine. Correspondant du Corriere della Sera à Paris à l'époque, j'avais fait un article sur ces spectacles : j'ai donc passé beaucoup de temps avec ces amis au Théâtre et je me suis particulièrement lié avec Russolo.
L'été de ce même 1927, à l'occasion d'un voyage en Italie, je me suis arrêté un jour à Milan (où Russolo était retourné entre-temps) et j'ai passé la nuit chez lui, dans son appartement qui se trouvait à proximité de la Piazza del Duomo. Sa femme se trouvait en vacances, si je me souviens bien, sur le lac de Côme :
Je ne l'ai donc pas connue. Cette nuit-là, Russolo m'avait beaucoup parlé des débuts du futurisme et de sa propre évolution :
Comme vous le savez, il avait adhéré au futurisme en tant que peintre, initialement, mais s'était assez vite orienté vers la musique, qui avait toujours été sa vocation principale.
Je ne peux pas fixer exactement la date de son retour et de son installation à Paris, mais j'ai l'impression qu'elle se situe dans l'hiver suivant, 1927-1928, ou au printemps 1928.
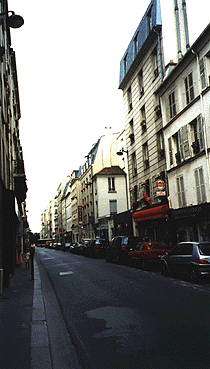 J'ai l'impression qu'il a habité, pour commencer, dans un hôtel
proche de ma propre maison (à l'époque, rue Berthollet), puis, je ne
sais pas en quelles circonstances, il a fait la connaissance de Fanny Hefter et est
allé vivre avec celle-ci. Ils logeaient, si
je ne me trompe, rue de Vanves (actuellement, rue Raymond Losserand - cf photo),
dans un petit appartement où je suis allé quelques fois.
J'ai l'impression qu'il a habité, pour commencer, dans un hôtel
proche de ma propre maison (à l'époque, rue Berthollet), puis, je ne
sais pas en quelles circonstances, il a fait la connaissance de Fanny Hefter et est
allé vivre avec celle-ci. Ils logeaient, si
je ne me trompe, rue de Vanves (actuellement, rue Raymond Losserand - cf photo),
dans un petit appartement où je suis allé quelques fois.Pour les milieux qu'il fréquentait, il y avait bien sûr les cafés de Montparnasse et les amitiés qu'on s'y faisait aisément, notamment parmi les relations de Fanny Hefter. Puis, De Torre et ses séances métapsychiques. Enfin, étant donné notre amitié, il venait, avec Fanny, presque tous les dimanches chez moi :
J'avais beaucoup de disques et j'aimais moi-même la musique; ces dimanches étaient donc des dimanches concert; ce qui me frappait, c'était la passion qu'éprouvait Russolo pour la musique classique, notamment Beethoven, et, le dirai-je, moins le Beethoven des Quatuors, par exemple, que le Beethoven de la IXe Symphonie...
G. L. - Avez-vous assisté à quelques-unes des soirées de Russolo jouant du Rurmorharmonium ?
N. F. - J'avais assisté, bien entendu, à la présentation du Rumorharmonium à la Sorbonne, en 1927. La soirée commença de manière bruyante à cause de l'intervention des surréalistes, qui étaient venus protester, surtout pour des raisons politiques (les futuristes passaient pour être fascistes). Quand on put rétablir le calme, il y eut, je crois, un discours de Marinetti, puis on procéda à la présentation de l'instrument, qui fut tout à fait décevante : non par la faute de l'instrument même ou de Russolo, mais parce qu'au passage de la frontière, les douaniers français, en examinant cet engin, qui leur paraissait mystérieux, n'avaient pas hésité à couper aux ciseaux quelques-unes des ficelles qui faisaient office de liens mécaniques à l'intérieur...
Mes souvenirs sont très vagues pour ce qui est de l'action " bruitiste " du Rumorharmonium. En somme, je ne l'ai vu à l'essai qu'à l'occasion de la soirée à la Sorbonne, soirée décevante comme, je viens de le dire. Même remarque quant à la façon dont Russolo en jouait. C'était une assez immense caisse en bois, avec toute une mécanique intérieure, mécanique assez rudimentaire puisque à base de ficelles.
 Russolo m'avait aussi parlé de l'utilisation
du Rumorharmonium pour des projections au Studio 28, mais, je n'ai pas eu l'occasion
d'y assister.
Russolo m'avait aussi parlé de l'utilisation
du Rumorharmonium pour des projections au Studio 28, mais, je n'ai pas eu l'occasion
d'y assister.G. L. - Pensez-vous quíon puisse dire que le bruitisme russolien représente le point de départ de la " musique concrète " ?
N. F. - Le " bruitisme " de Russolo (Intonarumori puis Rumorharmonium) est incontestablement à l'origine aussi bien de l'inspiration de Varèse que de la pratique de la musique concrète par Pierre Schaeffer et Pierre Henry.
G. L. - Quelles étaient les rapports entre Russolo et ce jeune intellectuel romain, De Torre, passionné de spiritisme ?
N, F. - Pour l'épisode De Torre, je crois qu'il a été extrêmement important pour Russolo, qui s'intéressait beaucoup à la métapsychique. Il m'avait parlé de ces séances, - mais il se trouve que je suis personnellement, et j'ai toujours été, très peu intéressé par ce genre de choses : c'est pourquoi Russolo avait très vite renoncé à m'en parler. Je n'ai donc jamais assisté aux séances de De Torre, que j'ai dû certainement rencontrer avec Russolo, mais qui ne m'a pas laissé le moindre souvenir.
Mais je peux vous donner un détail amusant. Russolo ressemblait au Cardinal de Richelieu, tel qu'on le voit dans le portrait célèbre de Philippe de Champaigne : et conscient de cette ressemblance, il gardait dans son portefeuille et montrait volontiers une reproduction de ce portrait. Il le faisait d'une manière qui m'intriguait : comme en sous-entendant qu'il était lui-même une réincarnation du Cardinal... Il ne l'a jamais dit, mais je ne serais pas étonné qu'avec d'autres, des passionnés comme lui de métapsychique, il ait été plus explicite.
Bien sûr, cette ressemblance avec l'un des diplomates les plus astucieux qui aient jamais vécu était tout à fait illusoire, car Russolo lui-même était l'être le plus dépourvu d'astuces, simple, sincère, naïf même et désarmé devant la vie, ne nourrissant pas la moindre ambition, artiste jusqu'au bout des ongles mais fait pour une existence de contemplation et de méditation. Dans la pratique de la vie, aussi peu futuriste que possible...
G. L. - Qui était Fanny Hefter ?
N. F. - Fanny Hefter était, je crois, peintre, d'origine russe.
C'était une petite femme, blonde, très gentille, assez rieuse, et qui était très sincèrement attachée à Russolo. Intelligente, musicienne elle-même, elle accompagnait toujours Russolo chez moi, et ma femme et moi avions beaucoup de sympathie pour elle.
Elle devait avoir entre trente et trente-cinq ans, - devrait donc, si elle est toujours de ce monde, avoir à présent quelque quatre-vingt-cinq ans.
J'ai perdu sa trace. À un moment donné, que je ne peux pas situer, Russolo est rentré en Italie et je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Je dois dire qu'à partir de 1928, pour raisons politiques, j'avais rompu tous rapports avec l'Italie. Russolo avait lui-même des sentiments antifascistes, et, je crois, c'était la raison de son installation à Paris. Mais il gardait, à Milan, son appartement et sa femme légitime...
G. L. - A quel niveau peut-on situer son antifascisme ? Etait-il profondément idéologique ?
N. F. - Russolo avait des sentiments antifascistes, à l'encontre des autres futuristes, qui avaient presque tous suivi Marinetti en s'inscrivant au parti. Je crois bien me rappeler que cette opposition au fascisme était un des motifs principaux de son émigration à Paris. Mais c'était, si je puis dire, un antifascisme purement sentimental, comme on pouvait l'attendre d'un idéaliste tel qu'était Russolo : il ne s'est jamais mêlé d'une action directe. Et il ne parlait pas souvent de la question.
Du reste, une preuve de l'antifascisme de Russolo est donnée par notre amitié et la fréquence avec laquelle nous nous voyons : entre 1928, quand je coupe les ponts avec l'Italie, et 1933, où je pars me soigner en sanatorium et cesse donc de voir Russolo, je suis souvent attaqué par la presse fasciste et la plupart de mes amis italiens oublient mon adresse... Or, c'est justement la période de la grande amitié avec Russolo.
Nino FRANK.
